Shopping Cart
Your shopping cart is empty
Visit the shop
1er Colloque de linguistique russe (Grenoble, mars 1973)
publié sous la direction de Claude Robert
ISBN 978-2-7204-0098-8, 1975, 179 p.
2e Colloque de linguistique russe (Paris 1977)
publié sous la direction de René L’Hermitte
ISBN 978-2-7204-0149-8, 1979, 224 p., tableau en dépl.
3e Colloque de linguistique russe (Aix-en-Provence, 1981)
préface Paul Garde
ISBN 978-2-7204-0189-3, 1983, 368 p.
4e Colloque de linguistique russe (Toulouse, 1984)
publié sous la direction de Maurice Comtet
ISBN 978-2-7204-0226-5, 1986, 343 p.
5e Colloque de linguistique russe (Poitiers 1987)
publié sous la direction de Jean Breuillard
ISBN 978-2-7204-0239-5, 1989, 546 p.
À l’aube de la Russie moscovite. Serge de Radonège et André Roublev
par Pierre GONNEAU
ISBN 978-2-7204-0435-1, 2007, 368 p., 24 planches hors texte en couleur
Légendes et images (XIVe-XVIIe siècles)
Serge de Radonège († 1392) et André Roublev († v. 1430) sont connus de tous ceux qui s’intéressent à la spiritualité et à l’art sacré russes. Réformateur de la vie religieuse, saint charismatique protecteur de l’orthodoxie et de la dynastie moscovite, Serge est surtout le fondateur de l’abbaye (Laure) de la Trinité qui, depuis 1342, est l’un des cœurs battants de l’identité russe. C’est pour l’ornementation de l’abbatiale du monastère, construite entre 1422 et 1427, que Roublev peignit la fameuse icône de la Trinité, sans doute l’image russe médiévale la plus diffusée dans le monde. « Pour comprendre la Russie, il faut comprendre la Laure, pour pénétrer dans la Laure, il faut étudier avec la plus grande attention son fondateur » écrivait en 1919 Pavel Florenskij, intellectuel et religieux, moine et ingénieur, mystique défenseur d’une idéale synthèse entre cénobitisme et communisme. Il ajoutait que si la fameuse icône de la Trinité est, certes, due au pinceau de Roublev, son véitable auteur est Serge, qui a su régénérer le mouvement monastique en Russie.
Ce livre rassemble le dossier des sources concernant Serge de Radonège et André Roublev. La partie la plus importante est consacrée à la traduction de la Vie de Serge, à partir du manuscrit dit de la Vie enluminée (v. 1589- 1592) qui comprend plus de six cents images. Les données des chroniques et des rares documents d’archives contemporains de l’existence de Serge ont été croisées avec le récit hagiographique. Parallèlement, les enluminures du manuscrit ont été rapprochées des autres images dépeignant Serge, en particulier des icônes.
La même approche comparative est appliquée aux notices de chroniques, les documents d’archives et les textes hagiographiques qui permettent de retracer – en pointillés – la carrière de peintre de Roublev, qui attestent de sa réputation de sainteté et qui montrent la renommée dont jouissait son œuvre.
Anna Akhmatova: recueil d’articles
publié sous la direction de Serge Dedulin & Gabriel Superfin
ISBN 978-2-7204-0243-2, 1989, 282 p.
Anton Tchékhov et la prose russe du XXe siècle
Jean Bonamour, éd.
2005, 160 p., ISBN 978-2-7204-0413-9
Un siècle nous sépare aujourd’hui de Tchékhov que l’on associe volontiers au théâtre. C’est pourtant du prosateur que se réclament davantage ses contemporains et successeurs. Les textes rassemblés ici mettent en évidence l’héritage que l’écrivain, disparu à l’acmé de sa puissance créatrice, a laissé tant à ses contemporains qui auront à traverser l’épreuve révolutionnaire qu’à ses héritiers plus lointains.
Ces articles montrent à quel point Tchékhov s’inscrit dans le tissu littéraire de son temps, en partageant avec ses pairs en littérature des choix formels, stylistiques, ou thématiques : novelliste comme Zochtchenko ou Bounine, auquel il était lié par une mutuelle estime. Une compassion dépourvue de sentimentalisme trouve un écho chez Boulgakov, médecin comme lui. Son voyage à Sakhaline représente son apport au thème pénitentiaire qui traverse la littérature russe de Dostoïevski à Soljénitsine et Chalamov. Comme Zamiatine et Kharitonov, il peint les mœurs provinciales et petite-bourgeoises. Maïakovski l’annexe au mouvement futuriste pour sa maîtrise de la langue.
Tchékhov lui-même, refusant d’escompter une gloire posthume, semblait espérer secrètement avoir frayé quelques voies pour des successeurs. Gageons que le lecteur pourra mesurer l’accomplissement de cette ambition.
Autour du skaz Nicolas Leskov et ses héritiers
par Catherine GÉRY
ISBN 978-2-7204-0442-9, 2008, 240 p., illustrations et noir et blanc
Le skaz de l’écrivain russe N. S. Leskov et de ses héritiers au XXe et au XXIe siècle, qu’ils soient « reconnaissants » ou « iconoclastes », témoigne de la permanence en Russie d’une culture du récit qui parvient à survivre à toutes les tentatives de déconstruction pour écrire/dire une autre histoire, en marge de l’historiographie officielle.
Dans le « skaz », la forme même du récit et ses modalités énonciatives sont posées comme un outil de connaissance et peuvent être assimilées à une véritable vision du monde. Par le biais de la réhabilitation de l’oralité et du principe narratif en littérature, le « skaz » propose des reconstructions compensatoires de la réalité, susceptibles de solliciter divers types de discours : on y trouve pêle-mêle les réminiscences de contes populaires, fables, légendes, chroniques, textes hagiographiques ou édifiants. Ces genres marqués au sceau du collectif et de la tradition ont été sans cesse revisités par les acteurs de la modernité. Du conte oral tel qu’il a été canonisé par Leskov au « monologue d’estrade » de Grichkovets, en passant par les tentatives de constitution d’une nouvelle prose soviétique au début des années vingt, « l’illusion du « skaz » » (selon l’heureuse expression de Boris Eichenbaum) s’est révélée féconde. L’héritage ne suit d’ailleurs pas une seule ligne chronologique : il est aussi transculturel (le « skaz » russo-juif, par exemple) et peut même faire se rencontrer plusieurs domaines esthétiques, avec les notions de skaz cinématographique ou de « skaz » scénique.
Jouant de codes conflictuels comme l’écrit et l’oral, le populaire et le savant, le verbe et le geste, le « skaz » semble donc voué à une perpétuelle remise en perspective, qui s’enrichit ici des apports de la linguistique, de la philosophie et de la théorie des genres.
Aventuriers russes du temps de Pierre le Grand
Histoires de marins, de chevaliers et de gentilshommes (1700-1730)
collection Bibliothèque russe de l’IES, volume 133
ISBN 978-2-7204-0543-3, 2016, 168 pages, glossaire des néologismes, bibliographie
textes traduits et commentés par Myriam d’AVEZAC-ODAYSKI
Pierre le Grand s’est intéressé à tout, sauf à la littérature. S’il se représente en démiurge, pétrissant et fondant la statue de la Russie nouvelle, et s’il convoque peintres, graveurs, poètes et historiens pour glorifier son règne, il ne revendique aucune ambition et ne manifeste aucun goût en matière de belles-lettres. Les spécialistes de ce domaine lui ont rendu son mépris en affirmant que son règne est le point le plus bas de la création littéraire dans son pays. La tradition de la littérature russe ancienne touche à sa fin, même si l’on continue de copier ça et là des chroniques, des récits édifiants ou satiriques, des vers syllabiques, des itinéraires de pèlerins et des Vies de saints. La littérature occidentalisée, acclimatant en Russie le roman, le drame et la comédie, la poésie classique, ou la presse d’information est encore en gestation. Et pourtant, il existe une poignée de « récits pétroviens » (petrovskie povesti) des années 1700-1730 qui lancent un pont entre les deux mondes. Ils s’extraient du cocon des oeuvres narratives traditionnelles, presque toujours situées à l’intérieur de l’espace russe, ou dans l’univers slave orthodoxe qui s’étend jusqu’à « Tsargrad » (Constantinopole), la « Montage Sainte » (le mon Athos), ou Jérusalem.
Ce livre est la première traduction française des trois principaux récits pétroviens : L’Histoire du marin russe Basile Kariotski, L’Histoire du chevalier russe Alexandre et L’Histoire du Fils de gentilhomme. Ils ont en commun de mettre en scène un héros nouveau, russe » au sens moderne du terme (rossijskij), marin de préférence, et entreprenant. S’il conserve précieusement sa foi orthodoxe et sa piété filiale, il part hardiment à l’étranger et se dirige, comme Pierre le Grand lui-même, vers la Hollande, l’Angleterre ou la France. Il entend y conquérir gloire et fortune, mais aussi et surtout science (nauka). Le monde qu’il sillonne est plein de périls et d’aventures, de femmes et d‘amour (en français dans le texte). S’y mélangent joyeusement les réalités du XVIIIe siècle et des réminiscences des romans de chevalerie ou des histoires galantes que les gentilshommes de France ou d’Angletterre connaissent bien. D’un épisode à l’autre, comme sur les tapisseries des Gobelins, notre marin russe est transporté de la rade de Londres où il manoeuvre avec la flotte de guerre, à un tournoi en armures ou à une embuscade de brigands dans une forêt impénétrable. Il passe du Décaméron à l’Amadis de Gaule, tout en suivant le Règlement de la marine édicté par Pierre. Deux héros russes sur trois meurent tragiquement à la fin de leurs tribulations, seul le marin Basile rentre heureux comme Ulysse, après avoir fait son long voyage. L’essentiel n’est pas le dénouement, mais le départ. Ces récits sont à l’image d’une aube nouvelle : l’air est frais, le vent se lève, les couleurs sont vives, l’aventure nous appelle.
Docteur en études slaves de l’Université Paris-Sorbonne, Myriam d’Avezac-Odaysky s’est spécialisée dans la traduction des oeuvres russes et ukrainiennes des XVIe-XVIIIe siècles.
Bibliographie des œuvres de Alexis Remizov
Hélène Sinany, Tatiana Ossorguine-Bakounine, dir.
ISBN 978-2-7204-0129-9, 1978, 255 p.
Bibliographie des œuvres de Gaïto Gazdanov
L. Dienes, Tatiana Ossorguine-Bakounine, dir.
ISBN 978-2-7204-0182-4, 1982, 64 p., 3 pl. h.-t.
Bibliographie des œuvres de Ivan Chmelev
par Dimitri Schakhovskoy
ISBN 978-2-7204-0156-5, 1980, 128 p.
Bibliographie des œuvres de Lev Karsavine
Alexandre Klementiev, Nikita Struve, préf.
ISBN 978-2-7204-0301-9, 1994, 64 p., 11 planches hors texte
Bibliographie des œuvres de Marc Aldanov
édité par Danuta [Monachon], Henri Cristesco et Tatiana Ossorguine, préface Marc Slonim
ISBN 978-2-7204-0111-4, 1976, XIII-87 p.
Bibliographie des œuvres de Marina Tsvetaeva
Tatiana Gladkova, Lev Mnukhine
ISBN 978-2-7204-0292-0, 1993, 2e éd. mise à j., 776 p., portr. front.
Bibliographie des œuvres de Nicolas Lossky
par Boris Lossky & Nedejda Lossky
ISBN 978-2-7204-0130-5, 1978, 129 p.
Bibliographie des œuvres de Serge Boulgakov
Kliment Naumov
ISBN 978-2-7204-0196-1, 1984, 160 p., 3 pl. h.-t.
Bibliographie des œuvres de Simon Frank
Vasily Frank, Tatiana Ossorguine-Bakounine, dir.
ISBN : 978-2-7204-0155-8, 1980, 108 p.
Boris Pasternak
Michel Aucouturier, éd.
ISBN 978-2-7204-0138-1, 1979, 560 p.
D. S. Mirsky Profil critique et bibliographique
Nina Lavroukine, Leonid Tchertkov
ISBN 978-2-7204-0164-0, 1980, 110 p., 6 pl. h.-t.
De l’Aube à l’Ob. Art, archéologie, ethnographie, par Joseph de BAYE (écrits de 1874-1925)
édité par Jean-Jacques Charpy, Pierre Gonneau, Michel Kazanski, Olessia Koudriavtseva-Velmans
Bibliothèque russe, volume 139, ISBN 978-2-7204-0617-1, 812 p., illustrations couleur et n & b, bibliographie, index des noms
Pierre Gonneau
PRIX PUBLIC TTC 48 €
Derjavine : un poète russe dans l’Europe des Lumières
Anita Davidenkoff, éd.
ISBN 978-2-7204-0306-7, 1994, 240 p., 8 planches hors texte
Embryologie de la poésie : introduction à la phonosémantique de la parole
par Wladimir WEIDLÉ
ISBN 978-2-7204-0157-2, 1980, 296 p.
Énonciation et détermination en russe contemporain
par Denis PAILLARD
ISBN 978-2-7204-0204-3, 1984, XXIII-464 p.
Essais sur Boris Pasternak
ISBN 978-2-7204-0563-1, 256 p.
par Michel AUCOUTURIER, édition préparée par Catherine Depretto
Si Boris Pasternak (1890-1960) est bien connu du public francophone, grâce à plusieurs monographies et à un important travail de traduction, son œuvre proprement dite n’a jamais fait l’objet en France d’un ouvrage spécifique.
C’est cette lacune que vient combler ce recueil de Michel Aucouturier. Réunissant pour la première fois vingt-trois articles, écrits entre 1961 et 2012, le livre aborde successivement la poétique de Pasternak, la spécificité du héros pasternakien, l’inscription du poète dans l’époque, l’étude de ses rapports avec la littérature française et russe (Balzac, Proust, Pouchkine, Tolstoï, Akhmatova).
Michel Aucouturier (1933-2017), professeur de littérature russe à la Sorbonne de 1970 à 2002, était un slaviste de renommée inter-
nationale et un éminent spécialiste de Pasternak. Un des quatre
traducteurs français de la première édition du Docteur Jivago (Gallimard, 1958), il a été le maître d’œuvre du volume Pasternak, paru en 1990 dans la bibliothèque de la Pléiade et l’auteur de deux livres sur l’écrivain (Le Seuil, 1963 ; Les Syrtes, 2015).
Études littéraires et historiques
par Michel GORLIN & Raïssa BLOCH-GORLINA
ISBN 978-2-7204-0078-0, 1957, 250 p., 2 portraits h.-t.
Eugène-Melchior de Vogüé, le héraut du roman russe
Michel Cadot, éd.
ISBN 978-2-7204-0240-1, 1989, 120 p.
Grammaire du texte et aspect du verbe en russe contemporain
par Jacqueline FONTAINE
ISBN 978-2-7204-0190-9, 1983, 366 p.
Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps
par Henri GRANJARD
ISBN 978-2-7204-0075-9, 1966, V-506 p., 2e éd.
Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et Nid de seigneurs
par Henri GRANJARD
ISBN 978-2-7204-0079-7, 1960, 239 p.
L’héritage du lexique indo-européen dans le vocabulaire russe
II. Nouveaux compléments au Dictionnaire étymologique de la langue russe de Max Vasmer
par Boris OGUIBÉNINE
ISBN 978-2-7204-0669-0, index des mots, 168 pages
Ces nouveaux compléments au Dictionnaire étymologique de la langue russe de Max Vasmer font suite à mon ouvrage L’Héritage du lexique indo-européen dans le vocabulaire russe (Paris, Institut d’études slaves, 2016).
Le très riche dictionnaire de Vasmer comporte nécessairement, comme toute oeuvre lexicologique qui date, des lacunes qu’il est utile de combler, surtout si l’on tient compte des avancées de la recherche dans le domaine de l’étymologie slave et indo-européenne, en progrès constant. De nouvelles hypothèses, ainsi que la révision des propositions étymologiques antérieures, se font jour et il est impératif d’en tenir compte.
Un constat tacitement ou ouvertement accepté est que la science étymologique est une parte de la linguistique diachronique où le renouvellement permanent est de mise. Il est en effet courant que les étymologies proposées se concurrencent, que les solutions précédentes sont estimées soit comme obsolètes, soit comme nécessitant corrections ou mises à jour à la lumières des nouvelles approches théoriques ou des faits linguistiques découverts par la recherche en dialectologie slaves et indo-européenne.
Il ne serait pas aberrant que cette seconde livraison des compléments au dictionnaire de Vasmer soit suivie de publications semblables en série continue, mais se contentera-t-on de citer ce vieil adage d’Hippocrate on ne peut plus adapté à la recherche étymologique : Ars longa, vita brevis.
L’héritage du lexique indo-européen dans le vocabulaire russe
Compléments au Dictionnaire étymologique de la langue russe de Max Vasmer
par Boris OGUIBÉNINE
ISBN 978-2-7204-0546-4, index des mots, 396 pages
Je salue la publication des compléments au Dictionnaire étymologique de la langue russe de Max Vasmer aux presses de l’Institut d’études slaves.
C’est une oeuvre solide, manifestant une érudition professionnelle vaste et profonde. Le but du volume est tout à fait justifié, car le grand dictionnaire de Max Vasmer (1958), tout en restant la source principale de l’étymologie russe et l’instrument indispensable de tout travail en slavistique, est néanmoins largement dépassé, suite aux développements des études étymologiques au cours des soixante dernières années.
L’ouvrage atteint dans une large mesure son but qui est de recueillir et de présenter les nouvelles solutions et les nouvelles hypothèses étymologiques, de même que les connexions génétiques qui n’avaient pas été remarquées par lui.
La plupart des nouveautés concernent le matériel indo-iranien ; le matériau du dictionnaire vieux-prussien de V. N. Toporov est cité abondamment.
Dans ces explications; l’auteur atteint assez souvent le niveau de reconstruction « laryngal », ce qui n’était pas le cas de Vasmer. Mais, à mon avis, il n’y dépasse pas une certaine mesure, ce qui permet au lecteur de percevoir quand même son volume comme une continuation de l’oeuvre de Vasmer.
A. A. Zalizniak
L’Occident vu de Russie, nouvelle édition 2017
Anthologie de la pensée russe, de Karamzine à Poutine
L’Occident comme modèle à imiter, rattraper, dépasser, régénérer, ou rejeter ?
ISBN 978-2-7204-0545-7, 790 pages, illustrations, index thématique et index des noms, bibliographie,
nouvelle édition revue et corrigée, juin 2017
140 auteurs – choix, présentations et traductions par Michel NIQUEUX
préface par Georges NIVAT
À cheval sur l’Europe et l’Asie, qui l’envahirent à plusieurs reprises, sans héritage gréco-romain ou catholique, occidentalisée de force (dans ses couches supérieures) par Pierre le Grand qui, au début du XVIIIe siècle, « perça » une « fenêtre sur l’Europe », la Russie a fait de son rapport à l’Occident non seulement une question géopolitique, mais aussi existentielle et philosophique : il en va de son identité nationale, de son organisation sociale et politique, de son « âme » ou de sa « civilisation », et du lien de celle-ci avec les « valeurs universelles » des Lumières. Dès le début du XIXe siècle, écrivains et penseurs russes débattent, et se divisent, sur les voies du développement de la Russie : faut-il protéger la Russie du poison européen de l’athéisme et de la dépravation (M. Magnitski, 1820), sauver l’Europe de la décadence (A. Kraïevski, 1837), ou devenir des Russes d’esprit européen (V. Biélinski, 1841), et suivre le même chemin que l’Europe occidentale, en nous gardant de ses erreurs (N. Dobrolioubov, 1859), pour ensuite la rattraper et la dépasser comme le voulaient les bolcheviks ? La « révolution conservatrice » actuelle, qui se développe en réaction à la perestroïka, avec son anti-occidentalisme, la dénonciation de la décadence de l’Occident « pourri », le rejet du modèle libéral-démocratique pour une voie russe originale, ou eurasienne (A. Douguine, 2011), ne peut être comprise sans remonter aux débats de la première moitié du XIXe siècle, qui restent d’une étonnante actualité.
Sans équivalent dans quelque langue que ce soit, cette anthologie, avec ses nombreux textes traduits pour la première fois en français, ses notices de présentation qui la rendent accessible au grand public, son absence de parti pris, permettra d’avoir du rapport intellectuel ou idéologique de la Russie à l’Occident une vue étendue et approfondie (140 auteurs, qui reflètent beaucoup mieux une réalité complexe et variée que les quelques dizaines de noms auxquels on se réfère d’habitude). Sur plus de deux siècles, on pourra suivre l’évolution d’idées antagonistes issues d’une part des Lumières françaises (droits de l’homme, État de droit, démocratie, principe individuel, cosmopolitisme), d’autre part du romantisme allemand (génie national, individualité nationale, idéalisme), et la permanence de mythes historiosophiques qui fondent l’altérité de la Russie et sa mission salvifique ou régénératrice. Cet ouvrage est nécessaire à tous ceux qui s’intéressent à la Russie présente ou passée ou qui veulent suivre le destin des idées européennes sur le sol russe.
Michel Niqueux est professeur émérite de l’Université de Caen Normandie.
La Bibliothèque russe Tourguénev à Paris
Tatiana Gladkova, éd., Tatiana Bakounine-Ossorguine, éd.
ISBN 978-2-7204-0228-9, 1987, 160 p.
La comédie d’Artaxerxès, présentée en 1872 au tsar Alexis par Gregorii le Pasteur
Texte allemand et texte russe
édité par André Mazon et Frédéric Cocron
ISBN 978-2-7204-0077-3, 1954, 296 p.
La forme brève dans la littérature russe
Mélanges offerts à André Monnier
publié sous la direction de Nora Buhks
ISBN 978-2-7204-0467-2, 2010, 292 p.
Ancien professeur de l’université Paris-Sorbonne, André Monnier est connu comme spécialiste de Novikov et de la littérature russe des XVIIIe et XIXe siècles.
Les mélanges que lui offrent aujourd’hui ses collègues, anciens élèves et amis, slavistes français et étrangers, rassemblent vingt-trois contributions qui ont pour thématique centrale la forme brève, envisagée prioritairement dans le contexte de la culture russe du XVIIIe siècle.
L’ensemble est précédé d’un entretien avec André Monnier et complété par une bibliographie de ses travaux.
La langue russe dans la seconde moitié du XVIIe siècle
par Frédéric COCRON
ISBN 978-2-7204-0081-0, 1962, 278 p.
La Maison de Smolensk
Une dynastie princière du Moyen Âge russe (1125-1404)
par Florent MOUCHARD
ISBN 978-2-7204-0531-0, 308 pages
En 1125, Rostislav, fils du prince de Kiev Mstislav le Grand et petit-fils de Vladimir Monomaque, reçoit pour domaine la ville de Smolensk. En 1404, son descendant direct, Jurij Svjatoslavič, perd définitivement sa principauté, conquise par le grand-duc de Lituanie. Entre ces deux dates, la dynastie issue de Rostislav a été un acteur majeur du jeu politique en Europe orientale. Participant activement aux luttes des clans issus de saint Vladimir, souvent maîtres de Kiev et de Novgorod, voire de la Galicie, étendant leur domination les territoires voisins de la principauté de Polock, entretenant des relations avec les établissements allemands de la Baltique et par-delà avec l’Europe du Nord, ses membres s’imposent par leur cohésion et leur pugnacité. Mais aux générations suivantes, la dynastie subit de plein fouet le contrecoup des crises des années 1230, si bien que Smolensk devient progressivement une petite principauté frontalière, bloquée entre la Russie en formation et le grand-duché de Lituanie.
Le présent ouvrage se propose, pour la première fois, de retracer l’histoire de dynastie de Smolensk et ainsi proposer une étude de cas sur l’aristocratie princière de la Rusʹ avant et pendant la formation des grands ensembles territoriaux de la fin du Moyen Âge. L’étude détaillée de l’abondante production annalistique de la Rusʹ est croisée avec les témoignages, nombreux mais dispersés, fournis par les documents diplomatiques, les sceaux, l’archéologie, et les autres sources narratives y compris étrangères.
Florent Mouchard est docteur en études slaves, professeur agrégé de russe à l’Université de Rennes. Ses recherches portent sur l’historiographie médiévale des pays slaves orientaux et l’histoire culturelle de la Russie et de l’Ukraine à l’époque prémoderne.
La matière du vers (texte en russe)
par Efim ETKIND
ISBN 978-2-7204-0213-5, 1985, II-507 p.
Материя стиха [La matière du vers] ouvrage en langue russe, 2e éd. corrigée
la Mort d’Osip Mandelstam (texte en russe)
Гибель Осипа Мандельштама
par Èdvin POLJANOVSKIJ
ISBN 978-2-7204-0276-0, 1993, 236 p.
La phrase monumentale russe ancienne retrouvée
par Marcel FERRAND
ISBN 978-2-7204-0267-8, 1992, 109 p.
La Russie en devenir : en hommage à Nikita Struve
Anita Davidenkoff, éd.
ISBN 978-2-7204-0361-3, 2002, 232 p.
Nikita Struve : une œuvre, un cheminement, par Anita Davidenkoff
Dostoïevski : un semblant de réflexion, par Philippe Jaccottet
André Monnier, Pouchkine ou la narodnost‘ transcendée
Marie Sémon, Quelques remarques sur l’art du portrait: Tatiana Larine
Claude De Grève, Pouchkine auteur des Récits de Bielkine et de la Dame de pique: vers un art de la nouvelle
Michel Aucouturier, Mandelstam et Chénier ou d’où vient le nom de l’acméisme?
Marc Raeff, Lettres parisiennes de Vladimir Vernadsky (janvier-avril 1923) (documents inédits)
Danièle Beaune-Gray, La réception de K. N. Leontiev dans l’émigration: N. A. Berdiaev et P. B.Struve
Igor Sokologorsky, La Russie selon Berdiaev
Pierre Caussat, Sens et puissance de la séparation (méditation libre sur l’hellénisme et ses résurgences tenaces)
Père Boris Bobrinskoy, Le patrimoine théologique de l’émigration russe
Serge Morozov, Foi et conscience dans l’œuvre de Merab Mamardachvili: une lecture des Méditations cartésiennes
Archimandrite Placide Deseille, Être chrétien orthodoxe aujourd’hui Nikita Struve
Victor A. Moskvine, La bibliothèque-fonds d’archives «L’Émigration russe»
Olga RaevskaÏa-Hughes, L’Action chrétienne des étudiants russes et son Messager: orthodoxie et culture
Jean-Paul Besse, Un regard orthodoxe sur l’Occident : le parcours du Messager orthodoxe
Claude Durand, Un portrait de Soljénitsyne
Georges Nivat, Entre élargissement et miniaturisation: la poétique de Soljénitsyne
Dimitri Schakhovskoy, Les Struve : monographie généalogique, index des noms propres
La Russie et la France des Lumières
Monarques et philosophes, écrivains et espions, par Alexandre STROEV
ISBN 978-2-7204-0551-8, 512 p., 483 illustrations en n & b, index des noms de personnes
Comment civiliser la Russie ? Le pays doit-il suivre l’exemple européen, comme le pense Voltaire, ou tracer sa propre voie, comme le suggèrent Rousseau et Diderot ? Au cours du XVIIIe siècle, en dialogue avec la France et d’autres pays, a Russie élabore ses propres Lumières. Elle réforme son système administratif, modernise son armée, fait fleurir les arts et les sciences.
Si Pierre Ier force le pays à endosser des habits étrangers, Catherine II les fait ajuster à la taille de l’empire et les confectionner chez soi. Des monarques et des penseurs, des diplomates et des aventuriers participent à ces changements.
Le livre étudie la circulation des idées entre la France et la Russie sous le règne de Catherine II, la mythologie des Lumières et son impact sur la politique. La Russie apparaît, à tour de rôle, ou bien comme un pays idéal qui se développe d’après les lois de la raison, ou bien comme un pays despotique et barbare qui menace l’Europe. Des récits de voyage, réels et imaginaires, offrent l’image du pays à civiliser. Voltaire et Casanova, le prince de ligne et Sénac de Meilhan, sans oublier des libertins sadiens, tentent de plaire à l’impératrice et la guider. Mission quasi impossible, car la « tsarine des Lumières » est passée maître dans l’art de gouverner les hommes. Et la diplomatie française anime une guerre de plume pour contrecarrer la montée en puissance de l’empire de Russie.
Alexandre STROEV, professeur de littérature générale et comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, étudie les relations culturelles franco-russes. Il est auteur et éditeur scientifique des ouvrages : Les aventuriers des Lumières (1997); Voltaire & Catherine II, Correspondance 1763-1778 (2006) ; L’image de l’Étranger (2010) ; La francophonie européenne aux XVIIIe-XIXe siècles (avec E. Gretchanaia et C. Viollet, 2012) ; Charles-Joseph de Ligne, Correspondances russes (avec J. Vercruysse, 2013), Savoirs ludiques (avec K. Gvozdeva, 2014) ; L’invention de la Sibérie par les voyageurs et écrivains français, XVIIIe-XIXe siècles (avec S. Moussa, 2014), etc.
Table des matières
C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumières
I. Voyages et voyageurs
la France et la Russie sur la carte mentale des Lumières
L’Île de la Félicité
L’odeur de l’étranger
Robinsonnade sibérienne
Les voyages du comte Jan Potocki à la recherche des antiquités slaves
La transmigration des arts et la destinée de la Russie
Annexes : Lettre de Jean Sylvain Bailly à Catherine II & Lettres de Volney à Grimm
Comment la France des Lumières inventa la Chine et la Russie, et ce qui s’ensuivit
La Russie vue par Mme de Staël et par Prosper de Barante : renversement des stéréotypes et batailles idéologiques
II. La tsarine des Lumières
Don Quichotte en jupon
Le chevalier d’Éon, collaborateur de l’abbé Fréron : défense et illustration de la Russie
Amazones des Lumières
L’Impératrice et le patriarche
Catherine II et Voltaire : correspondance intime et projets politiques
Voltaire en poète courlandais : l’Ode. Aux Confédérés de Pologne
Les oisillons du nid de Voltaire : le mythe du poète francophone des Lumières .
Un pélerinage imaginaire au Ferney russe
Des projets utopiques pour changer la Russie
Comment civiliser la Russie en élevant des vers à soie à Saratov : un projet inédit de Giacomo Casanova
Des inventions proposées à Catherine II
Annexe : lettre du chevalier de Joris à Catherine II
Le philosophe volant : Grimm juge de Jean-Jacques
La société impériale
La Société des ignorants et le cercle de l’Hermitage de Catherine II
Annexes :
Catherine II, Arrivée de Bélisaire en Scythie & Catherine II, Le Voyage en Tauride
Ordonnance singulière
Règlements affichés à l’entrée de l’Hermitage
Le prince de Ligne
« Si vous étiez ici, je ne ferais plus gémir les presses ni les lecteurs… » : les enjeux épistolaires du prince Charles-Joseph de Ligne
Le prince de ligne au siège d’Otchakov en 1788
Gabriel Sénac De Meilhan
Gabriel Sénac de Meilhan, éditeur de faux
« Un Voyage sentimental en Russie » de Gabriel Sénac de Meilhan
Une œuvre inconnue de Gabriel Sénac de Meilhan envoyée à Catherine II
Annexes : Lettres et essais de Sénac de Meilhan
III. Guerre de plume : diplomatie, espionnage et histoire
Séduire et soudoyer
Vivant Denon en Russie
Annexe : lettre du comte de Ségur à Grimm, 28 juillet 1785
L’histoire comme arme diplomatique
La Russie dans L’Esprit des Journaux (années 1770-1780)
Gouverner la Russie : Catherine II vue par Sade
Les faux testaments politiques de Frédéric II, Pierre Ier et Catherine II
La Russie entre Voltaire et Sade
Index
Table des illustrations
Les femmes dans l’œuvre de Léon Tolstoï
Romans et nouvelles
par Marie SÉMON
ISBN 978-2-7204-0202-9, 1984, 504 p.
Les fonctions de l’ordre des mots en russe moderne
par Jean-Pierre BENOIST
ISBN 978-2-7204-0127-5, 1979, 375 p.
Les particules énonciatives en russe contemporain [1]
par Denis PAILLARD
ISBN 978-2-7204-0215-9, 1986, 199 p.
Les propositions sans nominatif en russe moderne
Marguerite Guiraud-Weber
ISBN 978-2-7204-0200-2m 1984, VI-400 p.
Lettres d’un voyageur russe, Nikolaï KARAMZINE
Introduction, traduction, notes et commentaires de Rodolphe Baudin
Coédition avec les éditions L’INVENTAIRE, publié grâce au concours de l’Institut de la Traduction littéraire de Russie
780 pages, ISBN 978-235597-056-6, Bibliothèque russe R 129 BIS, illustrations en n & b, prix public 30 € TTC
Publiées entre 1791 et 1801, les LETTRES d’un voyageur russe de Nikolaï Karamzine (1766-1826) sont le premier grand récit de voyage littéraire produit par la littérature russe moderne. Double autofictionnel de l’écrivain, leur narrateur y décrit, sous la forme d’une correspondance factice, le voyage qu’il entreprit en 1789-1790 à travers l’Allemagne, la Suisse, la France et l’Angleterre.
Sentimental, galant, mais aussi et surtout curieux, celui que l’on appellera bientôt en Russie le « Voyageur russe » ou « notre Stern », y offre à ses lecteurs un tableau complet de chacune des civilisation rencontrées, s’arrêtant tant sur les paysages que sur les moeurs, les pratiques culturelles et sociales ou les chefs-d’oeuvre de la littérature et des Beaux-arts, sans oublier les événements dont il est témoin, à commencer par la Révolution française.
Philantrope et xénophile, le voyageur y propose également une galerie des grands hommes approchés, de Kant à Lavater en passant par Wieland ou Booent, ainsi que le récit fidèle de leurs entretiens. Ce faisant, il montre à ses compatriotes qu’un jeune Russe cultivé est digne du commerce des plus grands esprits de l’Europe, et les incite à suivre son exemple en se cultivant et en conquérant le vaste monde. Mais le voyageur parle également aux gens simples, des aubergistes allemands, aux bergers suisses en passant par les fleuristes parisiennes, et enseigne ainsi à la noblesse russe la bienveillance et la sympathie.
Ecrites dans une langue moderne et harmonieuse, dont l’attrait gagna à la littérature russe de nouveaux lecteurs, et notamment des lectrices, les Lettres d’un voyageur russe jouirent d’un vaste succès et firent l’objet de nombreuses imitations jusque dans les années 1820.
La présente édition en offre la première traduction française intégrale.
Professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, le maître d’oeuvre, Rodolphe Baudin, est spécialiste de la littérature russe du XVIIIe siècles.
L’Église des premiers saints métropolites russes
par Élisabeth TEIRO
ISBN 978-2-7204-0451-1, 2009, XII-421 p., illustrations en noir et en couleur
Il est difficile de comprendre l’orthodoxie actuelle sans s’intéresser à la métropole russe. Pendant cinq siècles, de 998 à 1448, la métropole « de Kiev et de toute la Rus′ » a fait partie de l’oikouméné byzantine. Elle était à la fois la plus lointaine et la plus vaste province ecclésiastique du patriarcat de Constantinople. Le métropolite, son chef, était presque toujours un Grec, jusqu’au XIIIe siècle, où commence à s’instaurer une alternance entre Slaves orientaux et Grecs ou Bulgares. C’est aussi à la fin du XIIIe siècle que le siège métropolitain passe de Kiev à Vladimir-sur-la-Kljaz’ma (1299), puis à Moscou (1328).
En 1448, l’Église russe devient autocéphale à son corps défendant, parce qu’elle rejette l’Union avec Rome que son métropolite grec avait acceptée le concile de Florence. Un siècle plus tard, les religieux russes assument cette rupture en affirmant que le flambeau de l’orthodoxie authentique brille à Moscou d’un éclat plus pur qu’à Constantinople. La théorie « Moscou est la Troisième Rome » (v. 1510-1540), le couronnement impérial du premier tsar russe (1547) et la création du patriarcat russe (1589) sont les conséquences de cette évolution.
La période qui va de l’établissement de la métropole à Vladimir à la création du patriarcat russe est abordée sous quatre angles : l’histoire des diocèses russes, la carrière des évêques et des métropolites, la reconnaissance de la sainteté des métropolites, dont deux (Pierre et Alexis) deviennent les patrons par excellence de Moscou et de l’Église russe, et enfin les possessions foncières de la métropole. À la lecture de cette monographie, c’est tout un pan de l’histoire religieuse russe qui se dévoile. Il devient possible de toucher de plus près les réalités du sol et des hommes, aussi bien que les inquiétudes et les attentes spirituelles d’une Église devenue l’ultime recours des croyants, car « il n’y aura pas de Quatrième Rome »…
L’émigration russe : revues et recueils (1981-1995)
index général des articles
ISBN 978-2-7204-0375-0, 2005, XII-348 p.
L’émigration russe en Europe. Catalogue collectif des périodiques en langue russe
Volume I, 1855-1940
édité par Tatiana Ossorguine-Bakounine, préface Marc Raeff
ISBN 978-2-7204-0248-7, 1990, 360 p., 2e éd. revue et complétée,
L’Opéra privé de Moscou et la naissance de l’opéra moderne en Russie
publié sous la direction de Pascale Melani
ISBN 978-2-7204-0487-0, 2012, 294 p., illustrations en noir et en couleur
L’Opéra privé russe de Moscou, connu également sous le nom d’Opéra Mamontov, est un opéra indépendant qui a existé en Russie à la fin du XIXe siècle, durant une période comprise entre 1885 et 1904, avec une interruption de 1888 à 1896. En dépit de sa durée de vie assez courte, cet opéra a joué dans l’évolution artistique de son pays un rôle sans précédent et sous-estimé par la plupart des études sur le théâtre musical.
Son fondateur, Savva Mamontov (1841-1918), est le cousin par alliance du metteur en scène Constantin Stanislavski et du collectionneur de tableaux Pavel Trétiakov. Industriel de profession, c’est aussi un mécène connu, fin connaisseur d’art et animateur du fameux Cénacle d’Abramtsevo, un des berceaux de l’Art moderne russe.
Dès les années 1880 et surtout à partir des années 1890, Mamontov consacre ses forces à la rénovation du spectacle lyrique. Sur la scène de son opéra privé, il élabore les principes de la représentation moderne, qu’il conçoit comme un tout harmonieux et réfléchi mettant en valeur l’idée contenue dans l’œuvre. Il invite à collaborer les plus grands peintres russes de l’époque (entre autres, Korovine, Serov, Vroubel) qui interviennent dans la mise en scène en même temps qu’ils dessinent les décors et costumes. Il monte les opéras russes à une époque où les Théâtres impériaux les négligent, crée dans son théâtre le Sadko de Rimski-Korsakov avec un succès retentissant, encourage les essais de chef d’orchestre du jeune Rachmaninov et favorise le début de carrière de cet immense chanteur-acteur que fut Fiodor Chaliapine.
Aucun ouvrage en français n’a encore été consacré à l’Opéra privé de Moscou, dont l’activité témoigne de la vitalité de la scène russe au tournant des XIXe et XXe siècles. La présente étude révèle l’émergence particulièrement précoce du concept de mise en scène lyrique en Russie.
Pascale Melani est professeur de langue et littérature russes à l’Université Michel-de-Montaigne – Bordeaux 3. Elle est l’auteur d’une étude sur Tchaïkovski (les Opéras de Piotr Tchaïkovski d’après les œuvres de Pouchkine, Toulouse, éditions Slavica Occitania, 2005) et d’articles sur l’opéra russe.
L’universalité de Pouchkine
Michel Aucouturier, éd., Jean Bonamour, éd.
ISBN 978-2-7204-0347-7, 2000, 486 p., édition de luxe sur papier ivoire
Manuscrits parisiens d’Ivan Tourguénev
André Mazon
ISBN 978-2-7204-0067-4, 1930, 203 p., 3 pl. h.-t.
Marina Tsvétaeva et la France : nouveautés et inédits
Véronique Lossky, éd., Jacqueline de Proyart, éd.
ISBN 978-2-7204-0367-5, 2002, 268 p.
Nikolaï Karamzin en France
L’image de la France dans les « Lettres d’un voyageur russe »
publié sous la direction de Rodolphe Baudin
ISBN 978-2-7204-0523-5, 228 pages, illustrations en n & b et couleur,
Fruit d’un colloque international organisé à l’Université de Strasbourg, le présent volume explore les différents aspects du regard porté sur la France par l’écrivain russe Nikolaï Karamzin (1766-1826). Premier prosateur russe moderne, Karamzin effectua en 1789-1790 un périple à la découverte des lieux et des acteurs de la culture européenne qu’il avait connus dans un premier temps à travers les livres. Dans ce périple, la France occupait une place primordiale, du fait de la prééminence culturelle dont elle jouissait en Russie depuis le milieu du xviiie siècle. À ce titre, la description de la patrie des plaisirs et du bel esprit remplit une large part de l’ouvrage que Karamzin tira de son voyage : les Lettres d’un voyageur russe, premier voyage sentimental épistolaire de la littérature russe. Rassemblant quatorze contributions, dues aux meilleurs spécialistes internationaux de l’écrivain, le recueil Nikolaï Karamzin en France s’arrête tour à tour sur les lieux visités par l’écrivain-voyageur, les rencontres qu’il fit, ses pratiques de consommation culturelle, le discours qu’il construisit sur la France après son retour, sans oublier la langue qu’il utilisa pour évoquer son expérience française. Inoubliable car longtemps désirée, celle-ci le fut également parce qu’elle fut marquée par le choc de la Révolution et, de manière plus intime, l’expérience personnelle d’une certaine marginalité. Ambivalente, sa richesse aida toutefois Karamzin à construire une figure de voyageur moderne, appelée à devenir paradigmatique, et joua un rôle décisif dans l’élaboration d’une francophilie russe exemplaire, fidèle, raisonnable et mesurée.
Poète dans la catastrophe
Vadim Kozovoï
ISBN 978-2-7204-0299-9, 1994, 331 p.
Quelques données historiques sur le Slovo d’Igor’ et Tmutarakan
édité par M. I. Uspenskij, André Mazon et Michel Laran
ISBN 978-2-7204-0082-7, 1965, 176 p., 4 pl. h.-t.
Russie profonde. De Pouchkine à Okoudjava, version en PDF
Poèmes et chansons russes traduits et présentés par Jean Besson
édition bilingue
préface de Véronique Lossky
Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique
Serge Karcevski, Irina Fougeron, éd., Jean Breuillard, éd., Gilles Fougeron, éd.
ISBN 978-2-7204-0397-2, 2004, XXIV-184 p., portrait
Cofondateur du Cercle linguistique de Prague, signataire, avec Roman Jakobson et Nikolaj Troubetzkoy, de l’acte de naissance de la phonologie — la célèbre proposition 22 soumise au IerCongrès international des linguistes à La Haye, en 1928, Serge Karcevski avait soutenu un an plus tôt à Genève sa thèse de doctorat sous la direction de Charles Bally, préalablement publiée à Prague en français : Système du verbe russe : essai de linguistique synchronique.
Penseur du mouvement («Synchronie ne signifie pas immobilité»), du déséquilibre fécond («glissement» et asymétrie du signe), du continu, Karcevski lègue aux linguistes d’aujourd’hui une œuvre toujours féconde et suggestive. Celle-ci, en effet, s’adresse, au-delà des spécialistes du russe, à l’ensemble des linguistes, si bien que la définition qu’il donne de son Précis de la langue russe en 1928 — « introduction élémentaire à la science du langage, fondée uniquement sur la langue maternelle » — s’applique à l’ensemble de son œuvre, depuis le Système du verbe russe jusqu’aux « Quatre plans sémiologiques de la langue. »
Ce classique jamais réédité était devenu depuis longtemps inaccessible.
Tables de la revue russe le Messager socialiste, 1921-1963 et du recueil le Messager socialiste, 1963-1964
ISBN 978-2-7204-0266-1, 1992, 392 p.
préface André Liebich
Tchékhov et la France
ISBN 978-2-7204-0263-0, 1992, 280 p.
Tolstoï aujourd’hui
ISBN 978-2-7204-0160-2, 1978, 296 p., Colloque international Tolstoï (Paris, octobre 1978)
Un autre Tolstoï
publié sous la direction de Catherine Depretto
ISBN 978-2-7204-0491-7, 288 p., index des noms
Écrire sur Tolstoï aujourd’hui, c’est chercher à comprendre, par-delà les clichés, ce que représentent pour nous l’écrivain et le penseur. Les vingt et une contributions de spécialistes français et étrangers rassemblées ici jettent de nouveaux éclairages sur son art et son enseignement, envisagés aussi bien dans la longue durée de leur réception et de leur interprétation qu’à travers russe des années 1910. C’est ainsi qu’émerge « un autre Tolstoï », ancré certes dans le XIXe russe et européen, mais aussi, en dépit de ses déclaration mêmes, un homme du XXe siècle, sensible aux orientations les plus modernes de l’art et de la société.
Un comparatiste avant la lettre : Ivan Pereverzev
et ses Préceptes de la rectitude grammaticale russe… à l’usage des Ukrainiens (1782)
édité par Sylvie Archaimbault et Serhij Wakoulenko
ISBN 978-2-7204-0464-1, 2010, 116 p.
Édité en 1782, sous le règne de Catherine II, cet ouvrage, la première grammaire du russe à destination des Ukrainiens, se présente comme un manuel du bon usage russe. Mais il est bien plus que cela, à savoir une véritable comparaison des deux langues, très fine en ce qui concerne les particularités phonétiques du russe et de l’ukrainien. La rareté des données relatives à la langue ukrainienne au xviiie siècle en fait une source précieuse. Par ailleurs, l’auteur contribue à la diffusion des analyses les plus contemporaines de la langue russe, qui se rallient à la théorie et à la pratique grammaticales françaises de l’époque. Ainsi considère-t-il les caractéristiques des langues étudiées comme un système, révélateur du « génie de la langue ».
Son auteur, Ivan Pereverzev (mort en 1794) est également l’auteur d’une Description topographique…, qui recèle maintes informations sur la vie et les mœurs des populations ukrainiennes.
Nous proposons ici une édition critique de la grammaire, les « Préceptes élémentaires de la rectitude grammaticale…, » accompagnée de sa traduction intégrale en regard et complétée d’un chapitre introductif destiné à replacer l’œuvre dans son contexte historique et linguistique, d’un appareil de notes et d’index.
Directrice du laboratoire d’histoire des théories linguistiques (CNRS/Université Paris Diderot), Sylvie Archaimbault est spécialiste de l’histoire de la pensée grammaticale et linguistique en Russie. Serhii Wakoulenko, professeur à l’Université de Kharkiv, a consacré de nombreux travaux à la slavistique, et notamment aux études ukrainiennes et polonaises.
Un publiciste frondeur sous Catherine II. Nicolas Novikov
André MONNIER
ISBN 978-2-7204-0175-6, 1981, 388 p.
Vie de Kain, bandit russe et mouchard de la tsarine
Ecatherina RAI-GONNEAU
ISBN 978-2-7204-0439-9, 2008, 384 p., illustrations en noir et blanc
Voleur, brigand, délateur, violeur et indicateur de police, tel est cet Ivan Osipov Kain, que la littérature transforme en 1775, vingt ans à peine après sa disparition des annales, en un mythe appelé à traverser les siècles.
Bandit-baladin, audacieux, rusé, invincible et souvent cruel, aussi habile à couper les bourses et à percer les coffres qu’à manier le jeu de mots ou le bout rimé, Van´ka Kain assassine, mais il fascine. Et pas seulement les auteurs de romans policiers.
Né avec le roman russe, il gagne ses galons de héros épique dès le règne de la Grande Catherine. Sous Eltsine, on ira ensuite jusqu’à le charger d’inculquer les vertus civiques et chrétiennes aux jeunes enfants… Entre-temps, il aura incarné aussi la liberté cosaque, la fierté nationale russe et redressé bien des torts, puis connu soixante-dix ans d’éclipse sous le régime soviétique.
Ce livre réunit pour la première fois les trois textes qui ont donné naissance au personnage légendaire : deux œuvres anonymes, le « Récit court » (jamais réédité sous sa forme originale depuis sa parution en 1775), « l’Autobiographie de Kain » (1777), et « l’Histoire de Van´ka Kain » (1779), un roman écrit par Matvej Komarov. Le cœur de l’ouvrage est donc constitué des éditions critiques de ces textes, à partir de toutes les éditions subsistantes du XVIIIe siècle, et de leur traduction. Il propose aussi une chronologie de la vie du véritable Kain, un aperçu du système pénal russe au XVIIIe siècle, un répertoire biographique des personnages historiques du récit et un petit guide de Moscou à l’époque des tsarines Anna Ioannovna et Élisabeth.
Voix et aspect en russe contemporain
par Denis PAILLARD
ISBN 978-2-7204-0150-3, 1979, 179 p.
préface Yves Millet
 Updating…
Updating… 
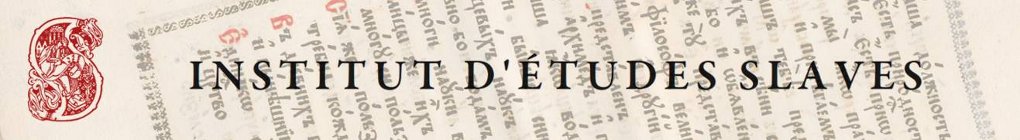



















































![Les particules énonciatives en russe contemporain [1] Les particules énonciatives en russe contemporain [1]](https://institut-etudes-slaves.fr/wp-content/uploads/1986/11/R75-160x240.jpg)




























